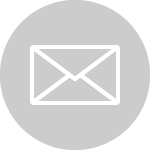Chères résistantes, chers résistants, chers soutiens.
La semaine dernière, nous avons continué à diffuser des extraits issus des auditions parlementaires visant à identifier les freins de notre réindustrialisation.
Bon, pour ceux qui y cherchaient du suspense, il n’y en a pas beaucoup. Ce sont les mêmes depuis 40 ans.
À écouter tous les intervenants interrogés par les animateurs de la commission (les députés Charles Rodwell et Alexandre Loubet), malgré quelques améliorations, on n’a toujours pas débarrassé nos entreprises de leurs 3 boulets au pied historiques. (Fiscalité excessive, tracasseries administratives envers les entreprises et les investisseurs, coût du travail et temps de travail).
Et, parce qu’en France, si on n’a pas toujours le sens des affaires, on a le sens du spectacle, on leur en a ajouté deux autres (boulets) : L’envolée des prix de l’énergie et la raréfaction du foncier. Une course d’obstacles, c’est quand même plus divertissant quand il y a des gadins.
Alors, évidemment, les mauvaises langues diront que cette commission d’enquête n’a pas grand intérêt. Elle va déboucher sur un rapport, comme les autres, qui donnera naissance à quelques demi-mesures, comme toujours. Et dans 3 ans, il faudra rouvrir une autre commission d’enquête sur les mêmes questions.
Mais aux FFI, on n’est pas mauvaise langue du tout. On est même pleins d’espoir, même quand l’heure de l’apéro est encore loin. Donc, on a écouté parler les grands témoins convoqués par les députés. Et on a bien fait, parce que c’était très intéressant.
L’un de ces grands témoins était Nicolas Dufourcq, patron de Bpifrance. Cette banque d’investissement joue un rôle majeur dans les politiques publiques de financement des entreprises françaises. Cela fait de son président un observateur éclairé de leur efficacité.
À un moment de son intervention, il pointait le rapport que les Français ont avec le capital, estimant qu’il était l’un des principaux freins à notre réindustrialisation. « Il y a un immense désir d’inconnu aux États-Unis, un immense désir d’inconnu en Chine. Mais pas en Europe. »
Nous avons diffusé l’extrait ici.

Selon lui, nous Français, prenons trop peu de risques avec notre épargne et l’investissons bien moins que les Chinois et les Américains dans les entreprises qui développent les produits et les services qui vont structurer le monde de demain.
Du coup, nos PME sont plus faibles, perdent des parts de marché en même temps que nous perdons notre souveraineté.
Pour Nicolas Dufourcq, le cycle qui fait que notre État s’endette et taxe excessivement les entreprises pour accorder des prestations sociales à son peuple (retraite notamment) est malsain. Car ces prestations sociales ne sont, selon lui, ni consommées, ni investies, mais bel et bien épargnées. Ceci à un rythme de 150 milliards d’€ par an.
Et c’est en raison de ce sous-investissement, de cette propension à placer tout notre argent sur des produits sans risque, qu’on aurait laissé les États-Unis représenter 52 % du private equity mondial (l’argent investi dans des entreprises non cotées), rattrapés chaque année un peu plus par la Chine. L’Europe toute entière n’en représenterait que 5 %…
Pour ceux qui ne voient pas bien ce que ça peut leur faire de voir les US investissent 10 fois plus que les Européens dans les entreprises non cotées, dites-vous qu’avec cet argent, ils prennent des parts dans les entreprises du monde entier. Et, à force de le faire, ils finissent par les racheter.
Bref, pour redire ce que le patron de Bpifrance explique, en y ajoutant une touche de provocation : La prochaine fois que vous vous indignez parce qu’une de nos jolies PME vient d’être reprise par un fonds américain, demandez-vous si c’est parce que vous avez oublié de mettre un peu de votre épargne dans des fonds français qui auraient pu se substituer aux Américains.
En gros, Nicolas Dufourcq rappelle aimablement que tout ce que nous mettons dans l’immobilier, les produits d’épargne garantis par l’État et les actions et la dette américaine ne soutient pas notre souveraineté industrielle.
Dans une autre audition de la même commission (celle de Louis Gallois et Pierre-André de Chalendar), on apprend d’ailleurs que 45 % des sommes que nous plaçons sur nos assurances-vie (placements garantis, donc sûrs) sont investies à l’étranger.

Notamment dans des entreprises qui, du coup, prennent des parts de marché chez nous et rachètent des PME françaises… Avec l’argent des Français.
Bref, à écouter le patron de BPIFrance, on aurait moyen de changer bien des choses nous-mêmes si on avait moins peur de l’avenir.
Alors, évidemment, le message de Nicolas Dufourcq mettant les épargnants français devant leurs responsabilités… a fait réagir des internautes.
Nous avons ainsi reçu des centaines de messages répondant au patron de Bpifrance quelque chose comme : « Si c’est pour perdre mon investissement parce que nos gouvernants surtaxent les entreprises, non merci. Réformez notre système d’abord. »
Et franchement, ça cette réaction est pleine de bon sens. Nicolas Dufourcq n’en disconvenait pas lui-même. Il disait, dans un autre extrait de la même audition, que la France devait rapidement se débarrasser de ses archaïsmes (ceux que j’ai cités au début de cette infolettre). L’extrait est ici.
Hasard de calendrier oblige, il se trouve qu’un des chapitres de notre prochain livre « La Réindustrialisation au pays des Shadoks » traite justement de ce sujet. (Il est en précommande ici.)
Il sera en librairie en septembre prochain. Nous le lancerons à l’occasion de « La Plage aux Entrepreneurs », un événement organisé par Origine France Garantie et la Mairie d’Arcachon auquel de nombreux membres des Forces Françaises ont l’habitude de se retrouver. (Préinscriptions ouvertes ici.)
Et vous allez voir, dans le résumé du chapitre que nous avons dédié à ce thème, que, contrairement à ce que pensent certains internautes libéraux (j’en faisais partie avant de m’être documenté), si la politique de l’État joue, elle n’est pas la seule responsable du sous-investissement chronique dont sont l’objet nos entreprises. Il y a, dans notre rapport au capitalisme, un vrai sujet culturel.
L’historien Alain Lecaire l’explique très clairement dans son ouvrage que j’ai déjà cité dans une autre infolettre : « France 1789-1914 : Une industrialisation à pas de tortue ».
Dès le début de la révolution industrielle, les milieux d’affaires français (appelons-les « la bourgeoisie »), qui ont pourtant largement participé à la révolution française, se sont très vite montrés bien moins entreprenants que leurs homologues anglais. Et en ce temps-là, n’allez pas chercher des excuses du côté d’une fiscalité exagérée, d’excessives réglementations écologiques ou d’un quelconque carcan de l’Union européenne…
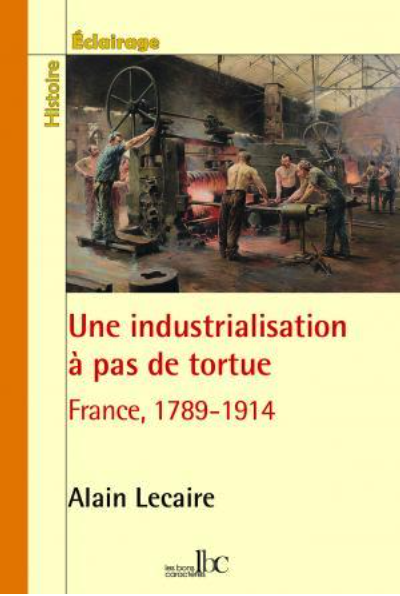
Rien de tout cela n’existait. Dès les XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, si certains d’entre eux créent des entreprises, d’autres, plus nombreux, une fois fortune faite, plaçaient leur argent dans des rentes sécurisées : terres cultivables, immobilier ou placements en dette d’État étaient couramment préférés à l’aventure capitalistique industrielle souvent considérée comme trop risquée.
Si certaines familles françaises se souviennent encore des emprunts russes, c’est parce que la France en a été le premier souscripteur.
(Ne vous moquez pas des choix hasardeux de nos aïeux qui croyaient placer leur argent sans risque avant de tout perdre avec l’État russe… Quand nous plaçons aujourd’hui notre épargne sur des produits « garantis », elle est majoritairement fléchée vers la dette publique d’un État ruiné, le nôtre, et le logement social, qui coûte plus cher qu’il ne rapporte. Donc bon… Pas sûr que ce soit moins risqué que d’investir dans nos PME.)
La cause de ce trait culturel tenace nous viendrait de loin : « En France, même quand la bourgeoisie se développe, écrit Lecaire, elle rêve de s’assimiler à la noblesse, comme ce bourgeois gentilhomme que ridiculisait Molière un siècle plus tôt. »
Un autre historien, Arno Mayer, a d’ailleurs eu cette autre formule : « L’ambition suprême de la bourgeoisie n’était nullement d’assiéger et de renverser la forteresse nobiliaire, mais d’y pénétrer. »
Autre analogie historique intéressante : si les banques anglaises du XIXᵉ siècle utilisaient couramment les dépôts des épargnants pour les prêter aux industriels, c’était beaucoup moins vrai en France. Le risque leur faisait déjà peur. « En conséquence, en France, comme au début du capitalisme, les commerçants continuent à se prêter entre eux »… Les PME manquaient donc déjà de financement, pendant que les banques plaçaient l’argent de leurs clients sur des produits financiers garantis moins risqués mais moins rentables.
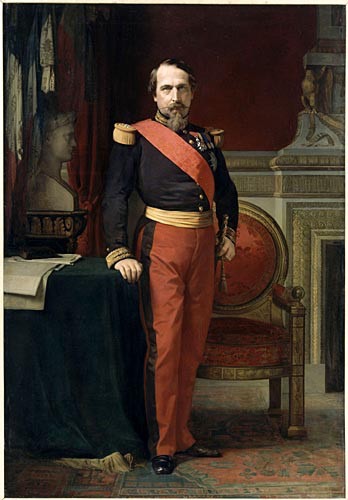
Il fallut attendre Napoléon III, qui avait passé plusieurs années en exil en Angleterre, et l’apparition de quelques industriels et banquiers particulièrement dynamiques (Schneider, Wendel, Pereire, Rothschild…) pour que la France accélère enfin.
Elle s’est alors dotée d’une banque centrale et de véritables banques d’affaires à l’anglaise, ce qui permit enfin à notre industrie de décoller.
On voit, au passage, l’importance que jouait déjà l’État en France dans la politique industrielle. Avant « Napoléon le Petit » (pas si petit que ça), Louis-Philippe avait donné l’exemple en prenant le développement des canaux en main.
Constatant le manque d’initiative de nos élites financières, l’État vint souvent leur prêter main-forte. Il empruntait de l’argent de la bourgeoisie, leur garantissant en échange une rente sans risque. Il prenait ainsi les risques à sa place.

L’État refera de même au XXᵉ siècle quand il fallut développer notre réseau d’électricité, le réseau autoroutier ou nos trains à grande vitesse quelques décennies plus tard.
Une princesse autrichienne de l’époque (Céline Dion) a fait de la pérennité troublante de notre rapport au risque une chanson : « On ne change pas… On enfile les costumes des autres et voilà. »
Mais Napoléon III et son interventionnisme d’État ne suffirent pas à compenser la différence de dynamisme entre la bourgeoisie française et ses homologues anglaises, américaines ou allemandes.
C’est ainsi que les chemins de fer se développèrent moins vite chez nous que chez eux, tout comme la marine marchande et les industries textiles et sidérurgiques. La France perdait donc chaque année du terrain dans la compétition que se livraient les puissances d’alors.
La fulgurante progression de la puissance industrielle allemande nous surprit d’ailleurs lors de la guerre de 1871.
Et il fallut l’avènement de la seconde révolution industrielle (organisée autour de l’électricité et non plus du charbon et de la vapeur), et la production d’un effort national considérable pendant la 1ʳᵉ guerre mondiale pour que la France se remette à niveau, malgré d’effroyables pertes et destructions.
Anecdote intéressante : alors que plusieurs Français étaient en pointe dans la mise au point des premières locomotives, le chemin de fer français se lança 10 ans après son concurrent britannique.
L’Académie craignant « que la santé des voyageurs ne résiste pas à de telles vitesses (40 à 60 km/h) » avait déconseillé au gouvernement de l’autoriser. (Principe de précaution avant l’heure.) De même, « des villes refusaient » déjà de laisser entrer le chemin de fer « et obligèrent les gares à s’implanter en périphérie ».
Bilan : « en 1848, le réseau français ne totalise que 3 000 km, trois fois moins que le réseau anglais ». Bref, ceux qui ont ruiné notre avance sur les OGM, les terres rares et les nouveaux réacteurs nucléaires n’ont rien inventé. Un successeur récent de René Coty a dit un jour que nous étions « des Gaulois réfractaires ». En fait, ce n’était pas si faux.
Ainsi donc, il est probable que Nicolas Dufourcq ait eu raison. Il y a bien un problème culturel entre les Français et le capitalisme. Et il est possible qu’il perdure en partie, même après des baisses d’impôts ou un hypothétique choc de simplification. Il semblerait donc que dans le cœur de tout héritier des révolutionnaires français (souvenons-nous que c’est la bourgeoisie qui a lancé la Révolution française) sommeille un rentier en puissance.
En fait non, pardon… Je ne voudrais pas vous donner l’impression que seule la bourgeoisie est en cause. L’amour de la rente a aujourd’hui gagné l’intégralité de notre bon peuple. Personne n’est dans la rue quand une loi anti-industrie va faire fermer des usines quelques années plus tard. Par contre, quand on touche aux retraites, au chômage ou aux allocs… C’est la guerre civile.
Bref, si on écoute bien les auditions, il va falloir qu’on apprenne tous à prendre un peu plus de risques si on ne veut pas continuer à glisser vers le déclassement.
Aux FFI, on s’y emploie via notre club d’investisseurs. On y met en contact ceux qui veulent placer un peu de leur épargne pour partager le risque que prennent les entrepreneurs, avec ceux qui cherchent à financer la croissance de leur PME.
Alors, si vous voulez participer, rejoignez-nous ici.
Bon, bien entendu, il n’y a pas que notre rapport à l’investissement qui cloche.
Notre problème est bien multifactoriel.
Et il faudra un jour que notre classe politique daigne nous réformer, aussi.
Affaire à suivre.